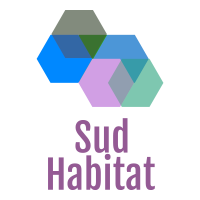La ministre du Commerce, de l’Artisanat et des PME, Véronique Louwagie, a annoncé sa volonté de réformer le titre-restaurant pour l’adapter aux nouveaux besoins des Français.
Des concertations ont été engagées avec les acteurs du secteur, avec l’objectif de bâtir un dispositif plus simple, plus équitable, et plus en phase avec les usages actuels. C’est une bonne nouvelle. Mais cette réforme ne pourra être pertinente que si elle part d’un constat simple : les bénéficiaires des titres-restaurant – les salariés – ne sont plus satisfaits du système tel qu’il existe aujourd’hui.
Derrière l’attachement indéniable à ce dispositif, perçu comme un soutien essentiel au pouvoir d’achat, se cache un sentiment de frustration croissante. Car les usages ont changé, les besoins aussi. Or, le modèle n’a pas suivi, notamment chez les émetteurs traditionnels.
Le premier levier à activer concerne le mode de contribution des salariés. Par principe, les titres-restaurant impliquent une participation de l’employé. Mais chez les émetteurs traditionnels, cette part est prélevée directement sur le salaire, en une seule fois et systématiquement par avance — ce qui peut représenter jusqu’à 150 euros. Ce fonctionnement, hérité d’un autre temps, est de plus en plus remis en question : 78 % des bénéficiaires aimeraient pouvoir profiter de cet avantage sans que cela impacte leur salaire net. Dans ce contexte, les employeurs ont un rôle clé à jouer. Il leur appartient désormais de faire évoluer leurs pratiques, en choisissant des solutions plus équitables et innovantes, qui répondent réellement aux attentes de leurs collaborateurs. Un titre-restaurant utile est un titre qui n’ampute pas le pouvoir d’achat, mais le renforce.
Deuxième angle mort du système actuel : l’accumulation des soldes non utilisés sur les cartes. Près d’un salarié sur trois dispose d’un solde supérieur à 100 €, parfois jusqu’à plus de 1 000 euros. Des montants bloqués, inutilisables pour autre chose que de l’alimentaire ou de la restauration, qui restent “en sommeil” au lieu de servir l’intérêt immédiat de ceux qui les détiennent. Cette situation est révélatrice d’un manque de flexibilité dans l’usage des titres-restaurant.
Et pourtant, les attentes des salariés sont limpides. Ils veulent pouvoir utiliser leurs titres le week-end (86 % y sont favorables) et en grande distribution (80 % souhaitent que cela soit pérennisé), un “titre alimentaire” en somme, plutôt qu’un titre cantonné à un usage strict. Sur ces points, la réforme engagée par la ministre Véronique Louwagie semble aller dans le bon sens : maintien de l’achat alimentaire à consommer ultérieurement, autorisation d’utilisation le dimanche… Ces mesures traduisent une volonté d’adaptation bienvenue, qui doit désormais s’accompagner d’une réflexion plus large sur le modèle économique du titre-restaurant.
On ne peut plus concevoir une réforme des titres-restaurant sans poser la question de leur finalité réelle : améliorer la qualité de vie des salariés, leur permettre de mieux manger, de mieux vivre. Le législateur a un rôle central à jouer pour moderniser ce dispositif hérité de 1967, dont le potentiel est immense, mais qui reste encore trop souvent prisonnier de sa forme historique, maintenue par des acteurs établis et des lobbys corporatistes plus soucieux de préserver leurs intérêts que de répondre aux attentes des salariés.
Réformer, ce n’est pas seulement numériser. Le vrai enjeu, c’est de réconcilier la promesse du titre-restaurant avec la réalité vécue par ceux qui l’utilisent au quotidien. Cela implique de revoir en profondeur les règles du jeu : plus de liberté, moins de contraintes et surtout, la garantie que chaque euro alloué bénéficie réellement au salarié. Les parlementaires vont devoir voter prochainement une nouvelle loi très attendue, qui devra trouver cet équilibre et qui devra se projeter dans l’avenir et ses nouveaux modes de consommation et de travail. Les attentes sont claires. Il serait temps, enfin, de placer les bénéficiaires au cœur du dispositif.