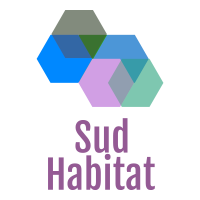L’appétit des marchés financiers pour prêter à la France prouve qu’il existe une analyse favorable de nos finances publiques à l’opposé du discours négatif matraqué dans les média
La dette publique française est-elle réellement un fardeau insoutenable ? Une lecture attentive du fonctionnement budgétaire de l’État, appuyée sur les pratiques de marché et une approche prudentielle, conduit à une conclusion iconoclaste : nos finances publiques seraient non seulement soutenables, mais potentiellement opulentes.
L’appétit des marchés : le jeudi à 11 h
Le jeudi à 11 h, les plus grandes institutions financières, très informées et conseillées par les meilleurs experts, se pressent pour acheter des Obligations Assimilables du Trésor (OAT), titres de dette émis par l’État français. L’Agence France Trésor, sous la tutelle du ministère du Budget, organise ces adjudications, où les offres dépassent régulièrement deux à trois fois les montants proposés.
Ce succès constant auprès des marchés interpelle. Deux visions radicalement opposées coexistent :
- Le groupe A : composé de responsables politiques, d’institutions publiques, des médias dominants, de la Cour des comptes et d’organismes européens. Ils considèrent la dette française comme un danger imminent.
- Le groupe B : formé des grandes institutions financières internationales très compétentes qui, semaine après semaine, engagent des capitaux massifs sur des durées longues. Leur jugement favorable est sans appel : la France reste un emprunteur de confiance.
Qui croire ? Ceux qui risquent leur argent, ou ceux qui en débattent ?
Le postulat de base du groupe A est de considérer l’État comme un ménage, soumis à des règles d’équilibre budgétaire. Or, l’État est une entité pérenne. Il n’est pas contraint à « rembourser » sa dette, mais à la refinancer.
Contrairement aux idées reçues, l’État n’emprunte pas pour « dépenser », mais pour investir dans la société. Il agit comme un créancier vis-à-vis de ses citoyens, auxquels il avance des services (éducation, santé, sécurité, infrastructures) remboursés via les prélèvements obligatoires. La dépense publique n’est donc pas une charge, mais un placement social et économique.
Un État investisseur, non dépensier
Chaque citoyen bénéficie, tout au long de sa vie, de services publics équivalents à plus de la moitié des richesses qu’il consomme. Ces services représentent une dette morale et financière remboursée progressivement.
Lorsque l’État emprunte pour servir la société, ce passif est compensé par un actif latent : son droit de décider des impôts et des prélèvements. Il n’a donc pas de dette mais des engagements. Le terme de dette est trompeur.
L’État, comme une banque, fait circuler l’argent. Il redistribue, investit, et prospère grâce au rendement de ses engagements(dette). Ce modèle n’est pas théorique : les études de Barro, Aschauer, Égert, ou celles du FMI, de l’OCDE ou de la Banque de France, estiment le rendement du capital public entre 3% et 7%.
La dépense publique augmente le PIB
La formule de calcul du PIB (PIB = C + I + G + (X – M)) intègre les dépenses publiques (G). Chaque euro investi dans la santé, l’éducation ou les infrastructures accroît le PIB. Si ces dépenses sont financées par la dette, alors :
Les dettes d’hier nourrissent en partie la croissance d’aujourd’hui. Et la dette de cette année prépare la croissance de demain.
La Comptabilité Publique, rigide, interdit de compenser une charge (les intérêts de la dette) par les recettes induites. Elle ne reconnaît pas les actifs créés par la dette. Ce qui est comptablement juste, mais économiquement faux.
Au moins 3 000 milliards d’investissements productifs en 30 ans
L’État a investi massivement depuis trois décennies : éducation (près de
3 000 milliards), hôpitaux, infrastructures, soutien aux entreprises (comme pendant le Covid). Ces investissements structurants produisent chaque année entre 90 et 210 milliards d’euros de PIB supplémentaire selon le rendement retenu. Avec un taux de prélèvement de 42%, cela représente entre 37 et 88 milliards de recettes annuelles, soit de quoi couvrir, voire excéder, la charge d’intérêts. Vérité économique que les rigidités de la Comptabilité Publique ne permet pas de révéler et qui explique pourquoi la France ne se heurte toujours pas au mur de la dette.
L’Allemagne jugée vertueuse en termes de dette est un pays aux infrastructures dégradées et à la défense insuffisante. Ce qui n’est pas le cas de la France. Ceci prouve que nos engagements(dette) ont bien servi à des investissements.
L’État, un acteur prudentiel… comme une banque
Comme une banque, l’État roule ses engagements (dette).
Les actifs financiers des administrations publiques sont estimés à 1 649 Md€, soit 58,4 % du PIB à la fin de 2023 (après 1 663 Md€ et 62,6 % du PIB fin 2022). Ils sont composés d’actions (participations de l’Etat dans des sociétés notamment) pour 43 %, de crédits pour 11 %, de liquidités pour 14 %, de titres de créance (obligations, par exemple) pour 3 %, des impôts et cotisations à recevoir au titre de l’exercice clos pour 29 %. (Source FIPECO)
En dehors des 29% qui sont difficilement négociable le reste l’est pour 1 154 milliards. Aptes à dégager à court et moyen termes des liquidités. Cette somme peut être considérée comme les fonds propres de l’État.
Si l’État était une banque, ses fonds propres atteindraient 1 154 milliards d’euros, ce qui lui permettrait, selon les règles de Bâle III, de porter jusqu’à 11 540 milliards d’euros ses engagements (dix fois les fonds propres). Or, ses engagements(dette) actuels sont inférieurs à 4 000 milliards. C’est peu. Très peu. Cela montre situation financière très solide.
Il bénéficie, en plus, d’une capacité de prélèvement stable, d’une base fiscale solvable, d’un système productif solide et d’une balance des paiements qui s’améliore. Autant d’éléments que les marchés financiers, chaque jeudi, ne manquent pas de prendre en compte.
Le véritable ratio : dette / prélèvements
Plutôt que le classique ratio dette/PIB, peu pertinent, comparons la dette au revenu public réel : les prélèvements obligatoires. En comparant une dette à un revenu, ce ratio rend mieux compte de la situation financière. Exemples :
- Suède : 81 %
- Allemagne : 155 %
- France : 248 %
- Espagne : 259 %
- Italie : 336 %
La dette française représente donc 2,7 années de revenu annuel. En comparaison d’un foyer, c’est modéré. La norme bancaire est bien plus élevée.
En tenant compte des taux de prélèvement de chacun la comparaison entre pays est plus juste que DETTE/PIB qui les ignorent. La France y est mieux classée. Mieux doté, un pays qui prélève beaucoup peut emprunter beaucoup.
Une autre stratégie est possible
L’objectif actuel est de ramener les déficits à 3 % du PIB d’ici 5 à 6 ans. Au terme de cette période, sans résoudre les problèmes principaux et en suscitant des frustrations dangereuses, cette politique de rabots entraînera inévitablement 1 000 milliards d’euros de dette supplémentaire. Pourquoi ne pas investir immédiatement ces 1 000 milliards dans un plan de reconstruction pour sortir de cette impasse ?
Éviter un chemin de croix récessif aussi coûteux que dangereux pour la cohésion nationale et la démocratie.
Un « New Deal » français de 1 000 milliards, permettrait de répondre aux défis du logement, de l’éducation, de la transition écologique et de la souveraineté industrielle. En générant une croissance durable, il pourrait réduire le déficit et renforcer la soutenabilité. On se retrouverait dans 5 ou 6 ans avec la même dette que prévue, mais avec une France relancée et apaisée.
La clé : une fiscalité dynamique, pas punitive
Grâce à la croissance, il est possible d’augmenter légèrement le taux de prélèvement obligatoire sans réduire le revenu disponible. Une formule le prouve. Si :
ΔT ≤ E × (1 – T) / (1 + E) (démonstration sur le site www.dette-publique.com)
Alors les impôts augmentent sans baisser le pouvoir d’achat. Exemple :
Avec T = 42% (taux actuel), E = 2% (croissance), si ΔT ≤ 1,13% les revenus restent stables. Soit une augmentation potentielle des recettes de 30 à 40 milliards d’euros par an sans perte de pouvoir d’achat.
Conclusion : une dette stratégique
Le véritable enjeu n’est pas la réduction dogmatique des déficits, mais le bon usage des ressources disponibles. La dette publique française, loin d’être un poids mort, est un levier stratégique. Encore faut-il oser l’utiliser intelligemment, en s’affranchissant des dogmes hérités du traité de Maastricht.
Le renouvellement des engagements (dette) contribue au produit intérieur brut et génère des recettes fiscales suffisantes pour couvrir la charge des intérêts. Ce mécanisme n’entraîne aucun coût direct et présente des effets favorables. Ainsi, il en ressort que la France ne dépasse pas ses capacités financières et ne vit donc pas au-dessus de ses moyens.
Alors pourquoi limiter le roulement des engagements (dette) ? Pourquoi priver le peuple de ce bienfait ?
Sortir du discours de la peur, entrer dans celui de la stratégie : voilà le véritable impératif. Car si l’on veut une France plus forte, plus juste et plus résiliente, il faut d’abord croire en ses propres moyens.